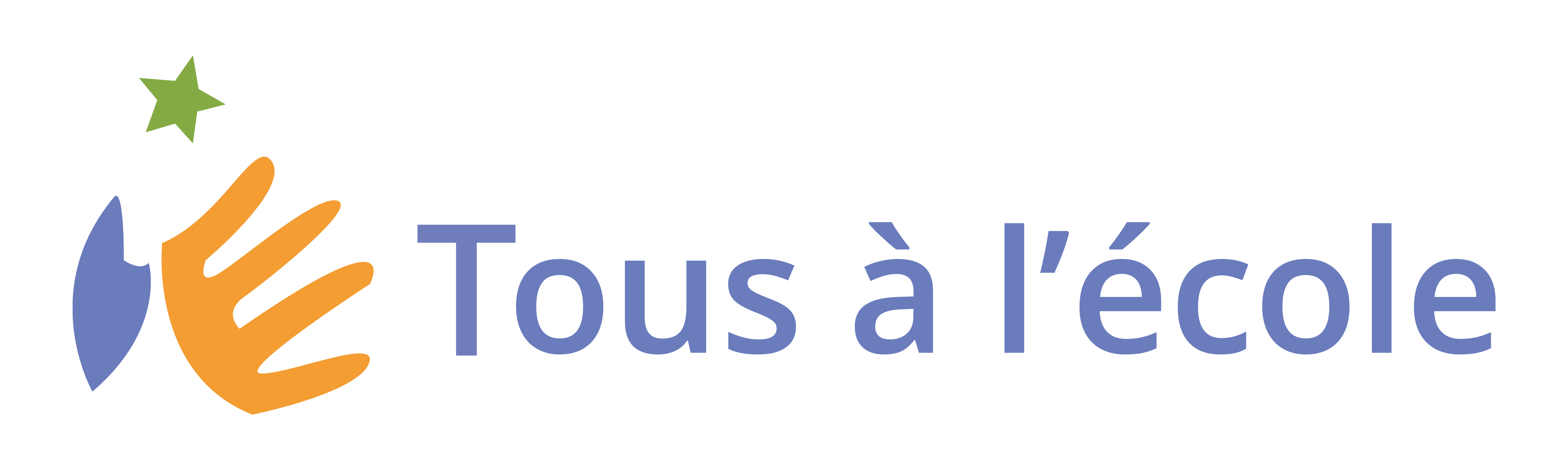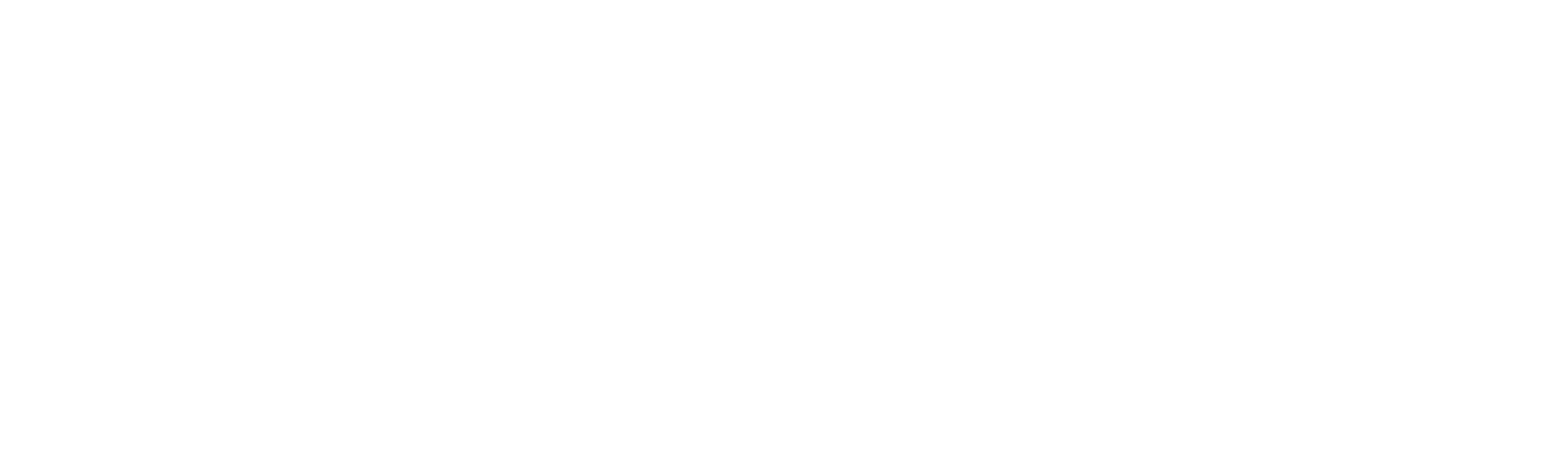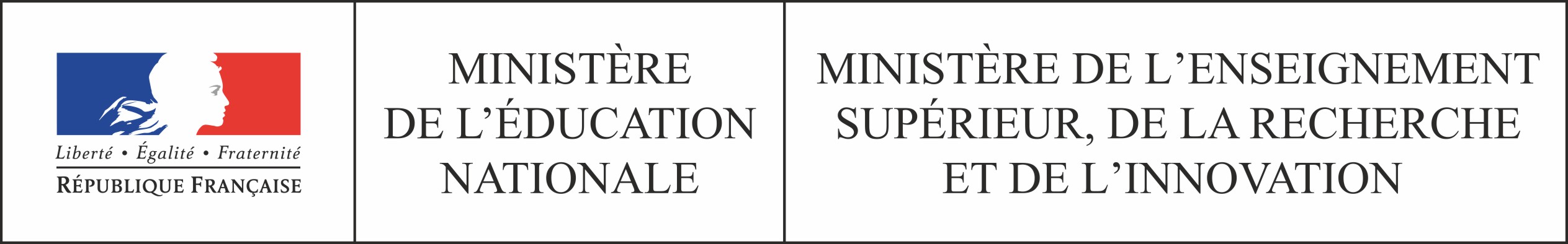L'inscription de l'enfant
Voir la loi 2005-102 du 11 février 2005
Dans la grande majorité des cas, un enfant inscrit et accueilli dans un établissement scolaire et qui se déplace en fauteuil roulant doit bénéficier d'un Projet personnalisé de scolarisation (PPS).
Lors de l'accueil de l'enfant, deux cas de figure peuvent se présenter :
1. Poursuite ou révision du parcours scolaire engagé sur décision de la de Commission des droits et de l'autonomie (CDA)
La CDA s'est prononcée sur le PPS et a pris une décision concernant l'orientation de l'élève ; la famille dispose des coordonnées de l'établissement et l'accueil de l'enfant a bien été préparé en amont de la rentrée de septembre. Les équipes pédagogiques, ainsi que l'enseignant référent, doivent avoir reçu les parents avant la rentrée.
2. Accueil consécutif à une première inscription, généralement en maternelle : si aucune démarche n'a été entreprise, l'équipe éducative est réunie par le directeur de l'école dès qu'un enfant en situation de handicap lui est signalé. Le directeur de l'école communique alors aux parents les coordonnées de l'enseignant référent pour la scolarisation des élèves handicapés dont le rôle sera d'informer, de conseiller et d'aider, tant les familles que les équipes enseignantes.
Le Directeur informe sans délais l'enseignant référent qui entre alors en contact avec les parents. Il aidera les parents ou les représentants légaux de l'enfant à saisir la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) pour qu'un projet personnalisé de scolarisation soit mis en place.
Suivi de la scolarisation
Le Projet personnalisé de scolarisation (PPS)
« ... définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap ... ».
Décret n° 2005-1752 du 30-12-2005
« ... organise la scolarité de l'élève handicapé et assure la cohérence et la qualité des accompagnements et des aides éventuellement nécessaires à partir d'une évaluation globale de la situation et des besoins de l'élève (accompagnement thérapeutique ou rééducatif, attribution d'un auxiliaire de vie scolaire ou de matériels pédagogiques adaptés, aide aux équipes pédagogiques par un emploi de vie scolaire)... ».
Circulaire n° 2006-119 du 31-7-2006, MEN, Desco.
L'équipe de suivi de scolarisation
« ... comprenant nécessairement l'élève, ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que le référent de l'élève... facilite la mise en œuvre et assure, pour chaque élève handicapé, le suivi de son projet personnalisé de scolarisation.
Elle procède, au moins une fois par an, à l'évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre.
Elle propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation ... »
Décret n° 2005-1752 du 30-12-2005.
L'enseignant référent
« ...est chargé de réunir l'équipe de suivi de la scolarisation pour chacun des élèves handicapés dont il est le référent. Il favorise la continuité et la cohérence de la mise en œuvre du projet personnalisé de scolarisation... ».
Décret n° 2005-1752 du 30-12-2005
Tout élève handicapé a un enseignant référent qui le suit tout au long de son parcours scolaire. C'est un enseignant spécialisé.
Ainsi lorsque, dans une école, un enseignant accueille un enfant en fauteuil roulant, il n'est pas seul face à cette situation, il peut s'appuyer dans son information, sa réflexion et ses propositions d'actions sur différents professionnels de l'éducation, de la santé ou des services sociaux ou médico-sociaux qui concourent à la mise en œuvre de ce projet et tout particulièrement sur l'enseignant référent.
Comment préparer l'accueil de l'enfant ?
1. L'accueil de l'enfant nécessite d'être préparé à travers la collecte d'un certain nombre d'informations.
Pour chaque élève, des solutions différentes seront trouvées car la réalisation de ses activités scolaires sera fonction de son identité, de ses choix, de sa déficience, de ses capacités et incapacités mais également des caractéristiques de l'environnement scolaire et familial.
La rencontre avec l'enfant et ses parents ou ses représentants légaux est la première étape dans la connaissance des besoins particuliers et des habitudes de vie de l'enfant en fauteuil roulant.
Selon son âge, l'enfant lui-même et ses parents sont à même d'apporter des informations sur sa capacité d'autonomie, ses capacités, incapacités, son degré de fatigabilité, etc. Une consultation avec le médecin scolaire est nécessaire.
Des échanges avec les enseignants qui ont accueilli l'enfant dans le passé permettent de bénéficier de l'expertise pédagogique qui s'est déjà constituée au cours des années précédentes.
La collecte de ces informations porte notamment :
- sur les moyens de renforcer les aptitudes de l'enfant et la compensation de ses incapacités ;
- sur la définition des obstacles qu'il peut rencontrer au cours de sa scolarité (accessibilité des locaux, préjugés) ;
- sur les ressources existantes...
2. L'information et la sensibilisation des autres élèves de la classe sont des facteurs déterminants dans la réussite du parcours de scolarisation de l'élève en fauteuil. De nombreux moyens pédagogiques peuvent être utilisés pour répondre aux interrogations des autres élèves valides : échanges, albums de littérature de jeunesse, activités avec d'autres fauteuils, documents vidéos, etc. autant de moyens qui peuvent être au préalable discutés avec les parents et l'enfant qui peut lui-même être amené à faire des propositions.
L'enseignant peut également compter sur la compétence et l'expérience d'autres professionnels (professionnels Sessad, médecins scolaires, psychologue scolaire, enseignant itinérant, rééducateurs, associations, etc.).
Quelques chiffres
Les données récentes permettent d'évaluer à 6 000 ou 7 000 le nombre d'enfants scolarisés, atteints d'une déficience motrice pouvant nécessiter l'usage d'un fauteuil.
Certains utilisent le fauteuil en permanence ou de manière intermittente, d'autres utilisent d'autres aides au déplacement telles qu'un déambulateur, des cannes tripodes.
Le besoin du fauteuil est fonction du type d'activité (sorties par exemple), de la fatigabilité dans la journée et de l'évolutivité orthopédique. Au cours d'une même journée un enfant peut avoir besoin de plusieurs modes de déplacement ou de postures.
Autonomie en fauteuil
L'enseignant trouvera auprès des professionnels de santé les informations nécessaires pour ajuster les activités proposée aux besoins et aux possibilités demander à l'élève.
Il devra obtenir des informations sur différentes questions :
- La capacité de l'enfant à conduire son fauteuil.
- Son degré de fatigabilité.
- Sa capacité à réaliser des transferts. (Transfert : dans le domaine du handicap moteur, désigne l'action qui consiste à déplacer son corps, se transférer d'un point à un autre. Exemple : du lit à un fauteuil roulant, d'un fauteuil roulant à un siège de WC ou à une baignoire...).
- Son installation dans le fauteuil.
- Sa capacité à évaluer des dangers ou risques potentiels.
- Les adaptations nécessaires pour certaines activités.
Dans la très grande majorité des cas, l'enfant a déjà appris avec l'aide de professionnels (ergothérapeutes ou kinésithérapeutes) à manier et maîtriser son fauteuil. L'établissement scolaire n'a pas pour mission l'apprentissage de la conduite d'un fauteuil, c'est le rôle des services spécialisés de soutien (Sessad).
Le rôle du Projet personnalisé de scolarisation (PPS) est de définir les besoins de l'élève en matière d'aides humaines, techniques et matérielles et de soutien pédagogique.
Ce PPS précisera notamment les nécessaires changements de posture au cours de la journée scolaire.
Les conditions matérielles d'accueil
Nombre de questions doivent être posées avant le premier accueil de l'enfant dans l'école en ce qui concerne l'accessibilité physique des locaux :
- l'accès à l'école doit être préalablement étudié ; le transport scolaire ordinaire ou spécialisé ; l'accessibilité autour de l'établissement scolaire.
- l'accessibilité dans l'établissement scolaire :
. Le gros œuvre : les salles de classes, l'accès aux WC, les couloirs, la cour de récréation (le bac à sable, les jeux...), si besoin ascenseur, rampes, plans inclinés et adaptation des salles de classe dédiées, etc.
. Le mobilier (table, chaise) et l'organisation du poste de travail (petites adaptations techniques : antidérapants, bacs de rangement mobiles...).
. Le second-œuvre (les sanitaires, lavabos et robinets, savons, séchage, porte-manteaux, rangement des affaires personnelles, du matériel scolaire).
. Le matériel de l'élève : le sac de classe, l'ordinateur, vêtements adaptés, etc.
. La situation en temps de pluie et les conséquences sur les conditions d'accessibilité (tapis, paillassons...).
- Les activités sportives : l'enfant y participera dans la mesure de ses capacités et le plus activement possible. Des aménagements de sa participation ou des alternatives seront réfléchies avec les membres de l'équipe de suivi de la scolarisation.
- L'accessibilité des lieux pour les activités péri-scolaires
La cantine ou restaurant scolaire (la table, le service), la bibliothèque, la piscine, le gymnase, etc. et le mode de transport nécessaire.
- Les activités sur les temps extra scolaires, les sorties scolaires et les séjours en classes de neige et les classes vertes. En lien avec les personnels soignants, tous ces temps seront prévus, anticipés en examinant tous les obstacles (dont les transports) qui pourraient restreindre la participation de l'élève en fauteuil. L'équipe de suivi de la scolarisation coordonnée par l'enseignant référent doit pouvoir examiner tous ces points et proposer des solutions dans le cadre du Projet personnalisé de scolarisation.
Le principe de base est que l'élève puisse accéder à l'ensemble des activités proposées dans le cadre de sa scolarité comme les autres élèves, en tenant compte de ses besoins particuliers.
Une réelle mise en situation dans tous les locaux doit permettre d'identifier les obstacles éventuels et les réponses à apporter : travaux d'aménagements, plans inclinés, adaptations, etc.
La responsabilité des travaux pour le gros œuvre incombe aux collectivités locales propriétaires des locaux selon le type d'établissement scolaire.
Les réponses aux contraintes liées aux transports et aux déplacements doivent être anticipées.
Le financement des adaptations et aides techniques doit être pris en compte dans le plan personnalisé de scolarisation après décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDA).
Les aides humaines
Une aide individuelle peut-être apportée à l'enfant par la présence d'un AESH ou Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap (antérieurement Auxiliaire de vie scolaire ou AVS) qui pourra intervenir afin d'apporter un soutien à l'élève et développer sa capacité d'autonomie, de communication, d'expression et d'apprentissage.
Il agit sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant et l'autorité du directeur d'école ou du chef d'établissement.
Pour les dispositifs d'intégration collective des écoles, établissements scolaires et d'enseignements professionnels du secteur public ou privé sous contrat (Ulis, Unités d'enseignement), l'Auxiliaire de vie scolaire collectif : (AVSco) peut intervenir avec une action tournée vers le groupe classe pour favoriser la socialisation, les relations interindividuelles, et la participation aux activités collectives de la classe.
Le projet personnalisé de scolarisation prévoit l'intervention de membres d'une équipe pluridisciplinaire de type Sessad ou Camsp ; ou de différents professionnels qui apporteront leur soutien et accompagnement dans le domaine de l'éducation, de la rééducation et du soutien pédagogique.
Le fauteuil
Le fauteuil de l'élève lui est spécifique et personnel.
Le fauteuil roulant est souvent considéré par certains qui l'utilisent quotidiennement comme un prolongement de leur corps. Ce n'est donc pas une aide technique ou un matériel comme un autre dans la mesure où il représente la condition essentielle, vitale d'une autonomie de déplacement.
Il existe différents types de fauteuils : fauteuils manuels, électriques, verticalisateurs (qui permettent à une personne handicapée de retrouver la station debout et l'aident dans les actes de la vie quotidienne).
Un fauteuil roulant est toujours prescrit par un médecin, à partir d'un diagnostic qui précise les indications et contre-indications. Le choix du fauteuil, les essais et l'apprentissage sont souvent réalisés par les ergothérapeutes. Le fauteuil est choisi à partir d'un bilan fonctionnel, des contraintes de l'environnement, des mesures anthropomorphiques et d'un bilan des activités quotidiennes. Ceci permettra aussi de personnaliser le fauteuil et les accessoires.
L'enseignant de l'enfant peut obtenir des professionnels d'une équipe pluridisciplinaire l'ensemble des informations qui concernent :
- La capacité de l'élève à diriger et maîtriser son fauteuil (vitesse, terrain accidenté, etc., connaissance de ses devoirs de prudence vis-à-vis des autres).
- L'installation de l'élève, le réglage des repose-pieds, le rôle des différentes adaptations ou éventuels accessoires (coussin anti-escarres, repose-tête, tablette, table à plateau mobile, etc.).
- La capacité de l'élève à réaliser partiellement ou non ses transferts (fauteuil-chaise, fauteuil-cuvette WC...).
- Les caractéristiques techniques du fauteuil : pliage, chargement d'un fauteuil électrique, poids, recharge des batteries.
- La nécessité d'adaptations techniques et pédagogiques.
- L'attitude à tenir en cas de casse ou panne avec des réparations pour l'essentiel effectuées par un fournisseur agréé apte à intervenir rapidement en cas d'immobilisation du fauteuil.
Quel que soit l'attrait du fauteuil pour les autres élèves, le fauteuil ne peut en aucun cas être un jouet ou un moyen de transport « collectif », en particulier enfant qui monte sur l'arrière du fauteuil pour faire le tour de la cour.
Les assurances
Il faut distinguer 2 situations, selon que l'enfant utilise un fauteuil roulant manuel ou un fauteuil roulant électrique.
1. Si c'est un fauteuil manuel
Concernant les dommages que l'enfant pourrait causer aux tiers avec son fauteuil, c'est l'assurance multirisque habitation qui joue (et parfois l'assurance scolaire, type MAE, s'il y en a une).
Concernant les dommages causés par une personne à l'enfant, c'est l'assurance Responsabilité civile de la personne qui joue et/ou l'assurance de l'école.
Concernant les dommages causés par une personne au fauteuil : idem.
Quoi qu'il en soit, il est souhaitable que les parents vérifient avec leur assureur les conditions de garantie nécessaire.
2. Si c'est un fauteuil électrique
Les fauteuils roulants électriques destinés aux personnes handicapées sont considérés comme des véhicules terrestres à moteur à partir du moment où ils peuvent rouler à une vitesse supérieure à 6 km/heure (supérieure à l'allure du pas) et doivent donc être obligatoirement assurés en responsabilité civile automobile (article L 221-1 du code des assurances), pour les dommages qu'ils pourraient causer aux tiers.
Concernant les dommages causés par une personne à l'enfant, c'est l'assurance Responsabilité civile de la personne qui joue et/ou l'assurance de l'école.
Concernant les dommages causés par une personne au fauteuil : franchise de responsabilité comme avec une voiture et éventuelle Responsabilité civile de la personne.
Dans ces hypothèses, la vignette verte d'assurance doit être apposée sur le fauteuil roulant.
Quant aux lieux de circulation, le principe est qu'un fauteuil roulant circulant à moins de 6 km/heure, peut aller partout où va un piéton (trottoir, chaussée, accotements, avec la prudence qui s'impose) et que celui qui roule à plus de 6 km/heure (fauteuil roulant électrique) peut circuler partout où circulent les voitures et respecter le code de la route (Art. R-217 et 218 du code de la route).
21/06/2017
Circulaire n° 2017-084 du 3-5-2017 : Missions et activités des personnels chargés de l'accompagnement des élèves en situation de handicap
Traitement de données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif » : Décret n° 2021-1246 du 29 septembre 2021 relatif au traitement de données à caractère personnel dénommé « Livret de parcours inclusif » (LPI)
Journal officiel lois et décrets - N° 0228 du 30 septembre 2021
Guide de l'accompagnement de l'étudiant handicapé en université
Publié en 2012 par la Conférence des Présidents d'Université.
Handicat (handicaps et aides techniques)
Handicat est une base de données nationale et neutre sur les aides techniques. Elle peut permettre de déterminer le matériel qui convient à une personne souffrant de handicap ainsi que son coût.
Mobilier adaptable
Ce site propose du mobilier d'ameublement thérapeutique pour les personnes handicapés (dont mobilier scolaire).
ORNA L'Observatoire national des ressources numériques adaptées recense des ressources numériques utilisables par des professeurs non spécialisés confrontés à la scolarisation d'élèves en situation de handicap (logiciels, applications tablettes, matériels, sites internet, cédéroms, DVD-Rom, bibliothèques numériques.
Guide sur la scolarisation des élèves en situation de handicap : MAIF Eduscol (2018)
Guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une déficience motrice (2001)
Ce guide Handiscol a été publié par le ministère de l'Éducation nationale en collaboration avec l'INS HEA. Disponible sur le site Eduscol
Loi du 11 février 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées
(voir en particulier l'article 19)